Comment essaimer les Tiers-lieux Autonomie sur son territoire ? – Guide
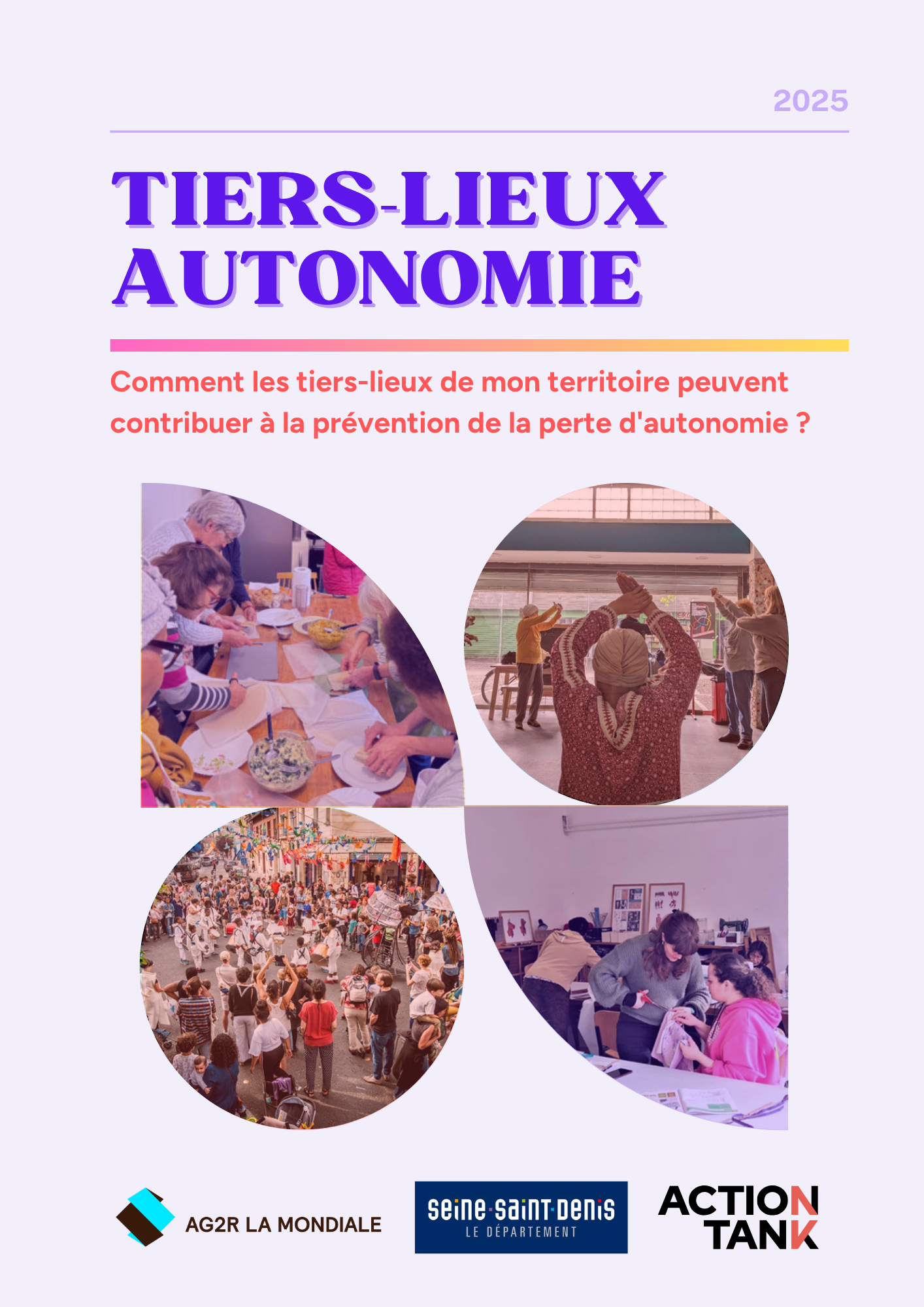 Comment les Tiers-Lieux Autonomie contribuent au mieux vieillir ?
Comment les Tiers-Lieux Autonomie contribuent au mieux vieillir ?
Face au vieillissement croissant de la population et au souhait de vieillir à domicile, les politiques publiques sont appelées à repenser leurs approches : comment prévenir la perte d’autonomie autrement, au plus près du quotidien des habitants ?
C’est à cette question qu’a voulu répondre le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, en lançant dès 2021 la politique publique pionnière « Tiers-Lieux Autonomie dans mon quartier ». A travers cette politique, le département a fait le choix de miser sur des espaces de proximité, ouverts à tous, proposant un accueil inconditionnel, convivial et non stigmatisant.
Véritables lieux ressources ancrés dans la vie locale où se croisent habitants de tous âges, aidants, associations et structures médico-sociales, les TLA contribuent à prévenir la perte d’autonomie par une l’écoute, la prévention, le lien social et l’amélioration de l’accès aux droits.
Aujourd’hui, le réseau de Tiers-Lieux est composé de 17 lieux répartis sur l’ensemble du territoire séquano-dionysien, avec l’objectif d’en atteindre 25 à l’horizon 2030.
L’année passée, le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a conduit une évaluation d’impact des Tiers-Lieux Autonomie, dont les résultats ont confirmé leur forte utilité sociale.
C’est dans ce contexte que l’Action Tank, partenaire du CD93 depuis 2019, a souhaité diffuser plus largement cette démarche et accompagner son essaimage à l’échelle nationale, en partenariat avec le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et avec le soutien d’AG2R La Mondiale.
Cette collaboration a donné lieu à la rédaction du guide « Comment développer un réseau de Tiers-Lieux Autonomie sur son territoire ? », destiné à partager les enseignements de l’expérience séquano-dionysienne et à outiller les acteurs souhaitant s’en inspirer.
Fruit d’entretiens menés auprès des porteurs de lieux, des acteurs institutionnels et des partenaires associatifs, ce guide explore de manière progressive les enjeux, leviers et conditions de réussite d’une politique publique inédite, et documente les modalités de réplication possibles sur d’autres territoires.
Il vise à répondre à plusieurs questions clés :
- Pourquoi développer des Tiers-lieux Autonomie ?
- Qu’est-ce qu’un Tiers-Lieu Autonomie et à quels besoins répond-il ?
- Quelles sont les conditions d’émergence et de pérennisation d’un tel réseau ?
- Quels enseignements tirer de l’expérience du Département de la Seine-Saint-Denis ?
- Et surtout, comment adapter cette démarche à d’autres contextes territoriaux ?
Plus qu’un retour d’expérience, ce guide est ainsi une invitation à repenser la prévention de la perte d’autonomie à travers des démarches collectives, locales et inclusives.
Il s’adresse à toutes les collectivités, acteurs de l’économie sociale et solidaire, bailleurs, associations et institutions médico-sociales désireuses de favoriser le bien-vieillir sur leur territoire.
Télécharger le guide, c’est découvrir une politique publique innovante, documentée et transférable, qui démontre qu’il est possible de conjuguer innovation, proximité et prévention contre la perte d’autonomie.
Bonne lecture !
Si vous souhaitez échanger à ce sujet, vous pouvez contacter :
Clémentine PAILHES (clementine.pailhes@actiontank.org) ou Mathilde BLANCHARD (mathilde.blanchard@actiontank.org)
2 fichiers à télécharger :Guide complet Essaimer les TLA sur son territoire – Oct.2025Executive_Summary_TLA

